L’ombre du vent, de Carlos Ruiz Zafón
Je me suis laissé forcer la main par Harris, un ex-collègue parti tenter sa chance sous d’autres cieux (et pour qui me connaît, c’est un peu comme forcer la main d’un enfant pour qu’il mange un bonbon : il n’y a pas énormément de travail).
Voilà un livre qui n’est pas banal.
La quatrième de couverture nous fait croire (malgré elle ? j’ai un doute) qu’on va lire un « roman littéraire », un livre sur les livres, une de ces mises en abîme fascinées/fascinantes sur un livre idéal que seul le personnage principal a eu la chance de lire.
Fort heureusement, on ne s’arrêtera pas à ça. Très vite l’histoire devient autrement plus complexe, et nous révèle des rebondissements et des circonvolutions qui évoquent tour à tour le Fantôme de l’Opéra, les livres de Paul Auster que je préfère —ceux de la trilogie New-yorkaise par exemple, où justement l’enquête tourne autour d’un livre, et où l’on finit par confondre le narrateur et l’auteur dans les jeux troubles de la narration en « je », et où une histoire dans l’histoire répond en écho à celle qu’on est en train de lire—, les polars noirs, les livres de promenade, les romans d’amour tragique (avec même une petite touche de Roméo et Juliette).
Le tout fort de deux histoires d’amour parallèles et d’épisodes périphériques (une mention spéciale pour le personnage de Fermín, picaresque en diable, clochard, espion et beau parleur truculent tout à la fois) qui finissent par subtilement introduire un des ressorts majeurs du roman, ce qui nous fait penser que cet auteur ne laisse décidément rien au hasard.
Et puis la langue, ah, la langue. D’une écriture raffinée, sans doute, mais comme je ne lis pas l’espagnol je me fie à la traduction, qui est tout bonnement excellente. C’est le deuxième livre écrit originellement en espagnol que je lis ces temps-ci qui en vient à me donner envie d’apprendre l’espagnol pour pouvoir les lire en version originale.
Quelle idée d’avoir pris allemand en deuxième langue au collège, comme tout le monde le souhaitait dans les années 80. La poésie de l’écriture espagnole (sans vouloir généraliser) a l’air fantastique, les phrases sont amples, alambiquées juste ce qu’il faut pour avancer des images évocatrices sans devenir laborieuses [1].
Marc [2] quant à lui m’avait lancé quelques mois auparavant sur Cent ans de solitude de Gabriel García Márquez, et m’avait dit qu’il est très typique de la littérature sud-américaine : long phrasé dû à la langue, intervention du surnaturel qui paraît normal à tout le monde, complexité des rapports héréditaires, associations de causes à effets étonnantes mais qui, curieusement, semblent évidentes quand on se laisse prendre au jeu. Au passage, Carlos Ruiz Zafón montre son admiration : un personnage secondaire s’appelle Buendia, comme la famille centrale du roman de García Márquez.
En bref, ce roman est épais mais se lit comme une fleur : une semaine ou deux de transports en commun et n’en parlons plus. Un régal.
Quelques citations
Sur la sincérité des personnages :
— Un bon père ?
— Oui. Comme le vôtre. Un homme possédant une tête, un coeur et une âme. Un homme capable d’écouter, de guider et de respecter un enfant, et non de l’étouffer sous ses propres défauts. Quelqu’un que l’enfant n’aimerait pas seulement parce que c’est son père, mais qu’il admirerait pour ce qu’il est réellement. Quelqu’un à qui son enfant voudrait ressembler.
Sur la truculence :
— Tout se perd, à commencer par la décence. C’est la première fois que vous venez chez moi, et je vous retrouve au lit avec la bonne.
Quant à l’humour distillé périodiquement :
— Pour l’amour de Dieu, allez vous coucher immédiatement, Fermín, dit mon père, horrifié.
— Pas question. Les statistiques le démontrent : il meurt plus de gens dans leur lit qu’au front.
Enregistrements pirates, de Philippe Delerm
Comme souvent, je finis un roman pendant l’aller. C’est le cas avec L’ombre du vent. J’arrive penaud à la gare en me demandant de quoi sera fait mon retour, mais je rechigne vraiment à l’idée de n’avoir rien à lire [3].
Je m’avance donc vers le point-presse, dubitatif : les magazines m’inspirent encore moins que pendant l’année scolaire (où, semble-t-il, il y a plus de choses à raconter —ou alors c’est moi qui fais ma mauvaise tête). Je détaille un à un les romans qu’on trouve dans un coin, et tombe, donc, sur Enregistrements pirates.
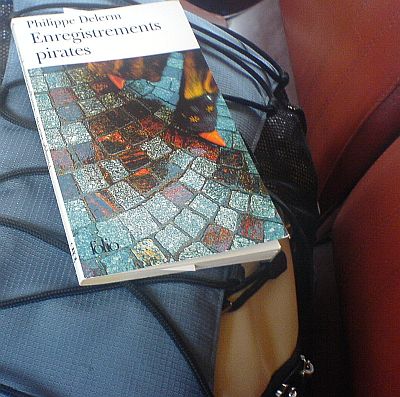
Je pense à Arnaud [4] qui me dit que certaines de mes anecdotes « vécues » sont delermiennes (on nous pardonnera le néologisme). Il n’a pas tort, mais je prends ça pour un compliment, même si je ne suis pas sûr que c’était l’intention première.
Comme j’ai déjà lu La sieste assassinée et que j’ai aimé, je me laisse tenter. Philippe Delerm, dans ses nouvelles très courtes, c’est comme un pastis délavé dans le midi, chaque historiette de deux pages est une gorgée de fraîcheur, qu’on prend presque sans y penser mais avec plaisir, jusqu’à ce qu’il n’y en ait plus.
Est-ce que Philippe Delerm a vocation à la postérité ? Nous n’en savons rien, mais son écriture ne témoigne pas de cette ambition. Elle veut plutôt essayer, modestement, de mettre le doigt sur les petites choses si difficiles à évoquer, même simplement à voir. Les petites choses que vous avez forcément entraperçues du coin de l’oeil, qui font partie du décor mais qui donnent, si vous y êtes attentif, toute la saveur à la vie quotidienne.
Delerm nous parle dans deux de ses nouvelles de Pietro Longhi, ce n’est pas un hasard si ce sont elles qui ouvrent et ferment ce recueil : comme lui, il préfère au monumental les petits moments de bascule, les phrases en équilibre, les secondes fragiles qui n’existeront déjà plus le temps de les décrire. Philippe Delerm est le Pietro Longhi de la littérature française contemporaine, et c’est très bien comme ça.
